Dans l’article précédent de notre série “Décroissance : de la récession à une sobriété soutenable et souhaitable“, nous avons introduit la notion de décroissance par une remise en contexte du débat actuel sur les limites de la croissance. L’analyse d’Adieu à la croissance de Jean Gadrey nous a permis de mieux cerner les contours du problème : si la fin de la croissance semble nécessaire, elle n’est pas encore socialement audible pour des raisons idéologiques (culture de la consommation, croyance dans la performativité de la croissance) et pratiques (difficulté d’un changement radical de paradigme économique et social). Pour continuer notre plongée dans la pensée des objecteurs de croissance et tenter de mieux appréhender la complexité de ce sujet, je vous propose aujourd’hui une lecture de Prospérité sans croissance de Tim Jackson.
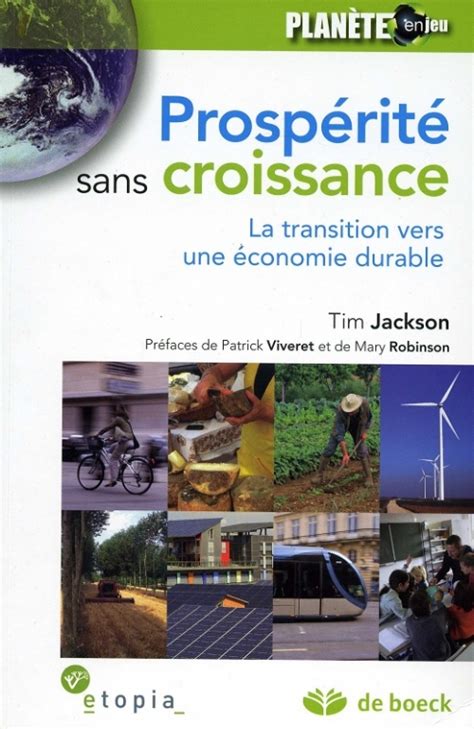
Ce rapport, réalisé pour la Sustainable Development Commission du Royaume-Uni, propose une troisième voie entre croissance verte et décroissance : dissocier la prospérité de la croissance. Le point de départ de la réflexion de Tim Jackson est la prospérité, étymologiquement définie comme la confiance dans l’avenir [1]. Elle relève donc d’une capacité à nous épanouir en prenant compte des limites finies de notre planète. Mais dans nos sociétés, nos espoirs et nos attentes étant d’abord matériels, l’idée de prospérité renvoie à un imaginaire de l’abondance, indissociable de la croissance. Or le dépassement des limites écologiques de la planète nous oblige à remettre en cause cette conception de la prospérité fondée sur la croissance ; la prospérité ne doit donc plus seulement être définie par des indicateurs économiques, mais aussi sociaux et écologiques. Comme l’explique Tim Jackson, notre vision contemporaine du progrès social est intenable : « Nous nous trouvons en danger réel de perdre toute perspective de prospérité partagée et durable ».
Lorsqu’on parle de croissance, on pense à celle du PIB. Mais il s’agit aussi de celle du throughput », c’est-à-dire du « flux de production » (flux de matières et d’énergie à partir de ressources environnementales limitées). L’économie a donc une taille contrainte par celle de son écosystème, elle ne peut pas croître à l’infini. Quelle prospérité est donc possible dans un monde aux ressources finies ? La croissance est-elle essentielle pour la stabilité économique et sociale ? L’un des problèmes du régime capitaliste réside dans le fait que la hausse de la productivité, en l’absence de croissance économique, engendre des pertes d’emploi (ce qui pourrait engendrer une baisse de l’épargne, de l’investissement, et à terme une récession). Un cercle tire donc les économies vers la croissance et le consumérisme : « dans une économie fondée sur la croissance, la croissance est essentielle pour la stabilité. Le modèle capitaliste ne propose aucune voie facile vers un état stationnaire. Sa dynamique naturelle le pousse vers deux états : l’expansion ou l’effondrement ».
Pourtant, dans les conditions actuelles la croissance n’est plus soutenable et la décroissance n’est source ni de stabilité, ni de consensus social. L’économie moderne semble donc structurellement dépendante de la croissance économique pour sa stabilité : peut-on cependant concilier un système économique en croissance avec un système écologique limité ? De nombreux acteurs proposent à cette fin un hypothétique découplage entre croissance économique et émissions de gaz à effet de serre.
L’un des apports majeurs de Tim Jackson dans son ouvrage est la clarification qu’il opère sur le concept de découplage en distinguant deux types de découplage : le découplage absolu et le découplage relatif. Dans le cadre d’un découplage absolu, les impacts environnementaux diminuent malgré la croissance du PIB. L’impact sur les ressources baisse donc en termes absolus. Le découplage relatif, quant à lui, peut être défini comme la diminution de l’intensité écologique par unité de production économique. Les impacts sur les ressources diminuent par rapport au PIB, mais l’impact environnemental et le PIB peuvent augmenter tous deux en termes absolus, tant que les impacts augmentent à un rythme plus lent que la croissance du PIB. Il serait donc possible de produire plus avec moins de ressources, ce qui suppose des gains d’efficacité. Cependant, on observe une baisse de l’intensité énergétique des économies avancées dans le dernier tiers du XXe siècle, ainsi qu’une baisse des intensités matérielles. Est-il donc possible d’envisager un scénario de croissance avec découplage, dans lequel le PIB continuerait de croître tout en respectant les limites écologiques ? Ce serait une échappatoire au dilemme entre croissance et décroissance. Selon les données étudiées dans l’ouvrage, il y a bien eu un découplage relatif au Royaume-Uni entre 1975 et 1995 ; mais tout découplage relatif est insuffisant. En effet, le changement climatique et la rareté des ressources sont des phénomènes planétaires à entrevoir à une échelle mondiale, et pas seulement nationale. Ce sont donc les tendances mondiales qui permettent de juger de l’efficacité d’un découplage absolu.
En référence à Amartya Sen, Jackson propose de choisir comme nouveau fondement de la prospérité : les « capabilités d’épanouissement » [2] garanties aux individus : être convenablement nourri, logé, chauffé, éduqué, etc. En effet, il ne faut pas confondre croissance et augmentation de la prospérité, puisqu’elle ne dépend pas des revenus. Plutôt que le revenu en lui-même, c’est la position relative dans la société qui semble importer. Par ailleurs, on n’observe pas de corrélation évidente entre croissance des revenus et éducation, santé, ou encore baisse de la pauvreté. Plutôt que de continuer à rechercher la croissance, il semble plus pertinent de réfléchir à la manière de partager plus équitablement et plus efficacement les ressources déjà disponibles. De nouvelles initiatives se développent à l’échelle locale et individuelle à l’instar des communautés intentionnelles, des regroupements de personnes souhaitant mener une vie plus simple et durable. Le principal problème de tels modèles est que ces initiatives de petites échelles entrent souvent en conflit avec la structure économique et sociale environnante, d’où l’importance d’un changement structurel.
Or, pour Tim Jackson, ce changement structurel nécessite deux transformations majeures : la réforme du modèle macroéconomique pour inclure les limites écologiques dans l’activité économique et une nouvelle gouvernance capable d’accompagner la sortie du consumérisme. Une telle gouvernance devrait permettre de se dégager d’une logique de court-termisme pour engager la société dans la prospérité, en engageant les citoyens dans la transition. Le principal frein à de telles transformations réside dans le dilemme de l’État entre encouragement de la consommation pour soutenir la croissance économique et assurance d’une vie épanouissante et durable prenant en compte les limites écologiques.
« Libérer la macroéconomie de l’exigence structurelle de la croissance de la consommation laissera, simultanément, l’État libre de jouer son propre rôle dans la fourniture de biens sociaux et environnementaux et dans la protection des intérêts de long terme ».
L’un des principaux leviers de la transformation structurelle à opérer est donc la mise au point d’un modèle macroéconomique écologique impliquant un nouvel équilibre entre consommation et investissement (une baisse de la consommation permettant une hausse de l’épargne, alors redirigée dans d’importants investissements nécessaires à la décarbonation), ainsi que de nouvelles variables qui incluraient la dépendance de l’économie à l’énergie et aux ressources. Ce nouveau cadre scientifique prendrait donc en compte les limites planétaires (contrairement au PIB, la dépréciation du capital naturel étant absente de la comptabilité macroéconomique actuelle) et favoriserait une relance verte consistant à investir pour sortir de la crise dans de nouvelles technologies nécessaires pour la transition écologique. Alessandro, Luzzti et Morroni [3] soulignent dans leurs travaux l’importance de l’investissement écologique, c’est-à-dire la transition des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables grâce à de nouveaux investissements réalisés dans ce qu’ils appellent une « fenêtre de durabilité », via une augmentation de l’épargne et de la part du revenu national consacrée à l’investissement. En effet, il n’est envisageable de soutenir un plus grand investissement que grâce à une hausse de l’épargne rendue possible par une baisse de la consommation. Les investissements écologiques (« New Deal vert ») à réaliser devraient ainsi permettre d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des ressources, développer des technologies propres et améliorer les écosystèmes.
Pour passer à une « prospérité sans croissance », Tim Jackson recommande également une réduction du temps de travail permettant de compenser les hausses de productivité, dans le cadre de ce qu’il appelle une « économie Cendrillon » d’entreprises écologiques et sociales ancrées dans les services locaux. Dans cette économie, les éléments exerçant une pression à la baisse sur la croissance sont la définition de limites écologiques, la transition structurelle vers des activités tertiaires spécifiques (incluant une plus faible productivité du facteur travail), la mise en place d’une fiscalité écologique, ainsi que l’allocation de ressources aux investissements écologiques nécessaires.
Dans son rapport, Jackson propose donc des solutions tant à l’échelle collective (systémiques) qu’individuelle (changement de mode de vie, sortie du consumérisme, etc). On peut cependant noter que la sortie du consumérisme est susceptible de provoquer un chômage de masse, en l’absence d’une réorientation massive de la main d’œuvre et des secteurs d’activité. Cette question sociale majeure est évoquée mais peu approfondie par Jackson ; d’autres penseurs de la décroissance se sont davantage penchés sur l’emploi, à l’instar de la sociologue Dominique Méda [4], dont nous reparlerons dans la conclusion de cette série d’articles.
Tim Jackson insiste par ailleurs sur le besoin d’avoir des étapes concrètes dans la transition pour ne pas rejeter d’un bloc toutes les institutions qui permettent une relative stabilité et une cohésion sociale. En bref, trois grands champs d’action sont selon lui nécessaires pour mettre fin à la croissance : « établir les limites, réparer le modèle économique, [et] changer la logique sociale ».
Jeanne Rodriguez
[1] pro + spes = conformément à + espoir
[2] capabilité = capacité concrète d’un agent pour agir comme il le souhaite, selon la définition qu’en donne Sen.
[3] Alessandro, Luzzti et Morroni, “Energy transition towards economic and environmental sustainability: feasible paths and policy implications” (2010)[4] Dominique Méda, La Mystique de la croissance, Comment s’en libérer (2014)
3 réponses sur « Tim Jackson, Prospérité sans croissance »
[…] Après avoir analysé la décroissance sous l’angle de la prospérité avec le rapport de Tim Jackson, on va notamment s’intéresser aux questions démographiques et politiques avec l’ouvrage de […]
[…] d’Adieu à la croissance, de Jean Gadrey. Les semaines prochaines, vous en apprendrez plus sur Prospérité sans croissance de Tim Jackson, Sortir de la croissance d’Eloi Laurent, Le pari de la décroissance de Serge […]
[…] Je trouve tous ces ouvrages théoriques sur la décroissance très intéressants dans la mesure où ils remettent en question un système que l’on a tendance à prendre pour acquis et qu’ils ouvrent de nouvelles perspectives. Cependant, je regrette de ne pas comprendre comment mettre les choses concrètement en œuvre pour aller vers cette économie de la décroissance, à la fois relationnelle et démocratique, presque un peu trop utopique… l’ouvrage d’Eloi Laurent est sous-titré « Mode d’emploi », mais il s’agit d’un mode d’emploi complexe à mettre en pratique ! Ces livres sont passionnants et très enrichissants, mais aussi risqués : à présenter une solution qui semble si difficile à déployer, il devient presque tentant de rester tétanisé sur place plutôt que de commencer à agir dès maintenant. Certes des préconisations sont faites et des exemples sont pris (Nouvelle Zélande, pays scandinaves, initiatives locales, etc) pour montrer que des progrès sont non seulement souhaitables, mais empiriquement possibles ; cependant, les pointer du doigt peut aussi mener à oublier que chaque cas est particulier et que la mise en pratique peut être plus difficile que prévue. Certaines assertions d’Eloi Laurent, comme le fait de sortir les entreprises d’une logique de maximisation des bénéfices, me semble théoriquement intéressante mais empiriquement compliquée à mettre en œuvre rapidement dans les années à venir, alors que le changement climatique fait déjà des dégâts et qu’il est urgent d’agir. Ce qui m’intéresse dans ces ouvrages (la remise en cause globale du système économique actuel) est donc aussi ce qui me gêne parfois (le manque de cas particulier et de plan d’action concret et détaillé). En l’absence de préconisations pratiques pour mettre en œuvre ces vœux pieux, je ne peux que demeurer sceptique malgré mon enthousiasme pour bon nombre de propositions… mais sans doute n’est-ce qu’une invitation à lire d’autres de ses livres et à creuser encore le sujet ! A cet égard, j’ai préféré l’aspect parfois plus pragmatique et empirique de Prospérité sans croissance de Tim Jackson. […]